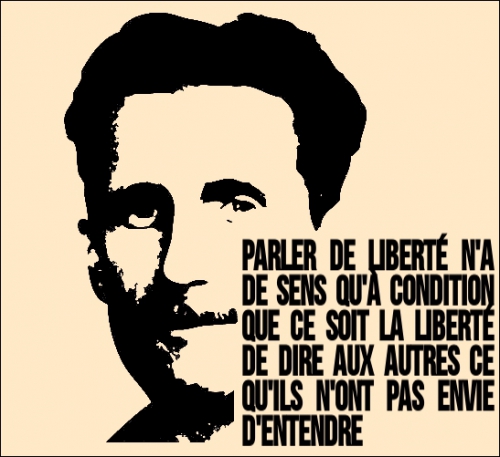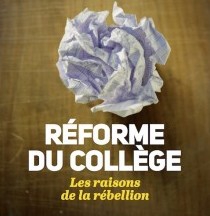Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Cédric Bellanger, cueilli sur Polémia et consacré à la question taboue de l'appartenance ethnique...

L’appartenance ethnique, au fondement des sociétés
Chaque société a ses tabous, surtout quand elle ne prétend pas en avoir. L’Occident hypermoderne a fort logiquement prohibé l’évocation de la question ethnique, qui est le démenti de son paradigme central, le triptyque rationalisme-individualisme-universalisme.
Pourtant, la vigueur, osons dire l’hystérie, qui anime les gardiens dudit tabou indique la fébrilité des Occidentaux face à une réalité qu’aucune formule magique, qu’aucun volontarisme ne parviennent à éradiquer.
Au fond, les simulacres de débats sur les questions dites de société comme la laïcité ou la délinquance ne sont que de longues et pénibles périphrases qui n’évoquent, tout le monde le sait, que la question ethnique, mais sans jamais prononcer le mot honni. L’admettre, même tacitement, c’est déjà reconnaître la nature et, partant, l’origine du problème.
Intellectuels, experts, spécialistes ou publicistes tournent autour du pot, effleurent la question et au dernier moment se ravisent, y compris les plus lucides. De temps à autres, un téméraire ou un naïf propose une connexion, une causalité, qui peuvent prendre le nom d’islam ou d’immigration, pour se voir rétorquer les mots magiques : « amalgame », «stigmatisation». C’est ainsi que se prolongent indéfiniment les palabres républicaines.
Les tabous, s’ils ont souvent leur utilité et leur raison d’être, voient parfois leurs fondements tellement sapés par la marche du Monde qu’ils deviennent un facteur de blocage potentiellement mortifère. Cette tendance à s’accrocher à des tabous obsolètes, à laquelle aucune civilisation ne peut prétendre se soustraire, s’explique aisément par la nécessité qu’ont les sociétés à élaborer un récit cohérent de leur devenir.
Chaque société se pense en effet dans un champ relativement clos. La formulation d’une vision du monde, si complexe soit-elle, implique nécessairement la négation d’une portion de réel – ainsi, le marxisme a pu nier l’autonomie du religieux ou du culturel, vus comme simples reflets d’un ordre socio-économique. Le monde est trop complexe pour être embrassé totalement ; aussi, lorsque nous le pensons, nous trions, rejetons puis nions l’existence des éléments entrant en contradiction avec nos représentations. Bref, penser le monde, c’est, par le biais d’une narration linéaire et souvent unidimensionnelle, évacuer une part plus ou moins importante de ses composantes pour le rendre intelligible et par conséquent vivable.
Indépassable limite de l’intelligence humaine !
En cela, l’hyper-modernité occidentale ne déroge pas au schéma d’ensemble.
Son moteur – le couple rationalisation/individualisation – suppose la négation de ce qui l’entrave : pas tant l’existence de groupes (la société au sens de Tönnies est avant tout perçue comme une association libre d’individus indépendants) que la survivance de communautés organiques, non choisies, qui s’imposent à l’individu car elles le précèdent, le déterminent et le perpétuent.
L’individu-maillon communautaire n’a pas sa place dans la grande mythologie hyper-moderne, qui porte aux nues l’individu émancipé de tous les déterminismes, à l’identité rhizome, dont l’horizon ne peut être qu’universel. Or, à l’épreuve des vicissitudes de l’histoire, la résilience de telles communautés, essentiellement définies sur des critères ethniques, nous paraît incontestable : des éléments structurels l’expliquent.
1/ L’ethnie, dans son principe comme dans sa réalité, ne se choisit pas et donc ne se défait pas.
On peut adhérer à un système de croyances ou de représentations, puis s’en détacher. Il peut alors ne rester aucune trace de cette adhésion ; l’individu ne s’en trouve pas ontologiquement affecté, et l’adhésion audit système de représentations n’aura été qu’un moment, achevé et non structurant, dans l’existence longitudinale de l’individu. Au contraire, l’identité ethnique, qui est factuellement un lien de filiation, peut être défaite en pensée mais pas effacée irrémédiablement. Un individu peut bien nier radicalement son identité ethnique, la potentialité d’un retour à celle-ci demeure toujours possible. Aucun cliquet ne rend impensable sa résurgence.2/ L’ethnie est également prégnante car elle résiste aux mutations idéologiques. Elle n’obéit pas, contrairement aux religions et idéologies, à un régime de vérité : une foi ou une théorie peuvent tomber en déshérence, pas une filiation qui contient en elle toute sa vérité. Ainsi, elle survit au temps court de l’histoire, aux idéologies, aux utopies : soixante-dix ans de communisme n’ont pas éteint l’âme russe, et en soixante ans, c’est la Chine qui a absorbé le maoïsme – le retour à Confucius ou à l’orthodoxie (qui est un christianisme national à forte valeur identitaire) en témoignent.
Presque immobile du point de vue des sociétés historiques, l’appartenance ethnique est le seul ferment identitaire qui ne peut s’épuiser tant que le peuple vit biologiquement.3/ C’est que l’ethnie correspond à un ensemble complet de référents qui intègre le corps et l’esprit : loin de se limiter à une noosphère éthérée, elle se lit sur la peau, sur le visage, dans l’ADN – autant de traces indélébiles qui, à défaut d’être structurantes en elles-mêmes (le sait-on vraiment ? peu importe) peuvent toujours être réactivées comme un signe incontestable et fixe (à notre échelle temporelle) d’appartenance. On observe la puissance de ce référent visuel qu’est le phénotype dans la tendance à l’ethnogenèse des minorités noires issues de l’esclavage dans le Nouveau Monde, coupées de leurs racines culturelles (langues, religions, systèmes de parenté…) mais qui re-forment un groupe ethnique (et pas seulement racial) par une appropriation détournée des codes sociaux majoritaires. D’où leur propension à se tourner vers une religion tout aussi minoritaire, comme l’illustre le succès des Églises évangéliques – voire d’un l’islam racialisé – chez les populations noires d’Amérique et des Antilles. Ici, la race (disons, le phénotype) va de pair avec l’ethnicisation, processus auquel le religieux semble soumis (car sur le fond, rien ne justifie, d’un point de vue théologique, l’existence de communautés religieuses « noires »).
4/ Aussi, l’appartenance ethnique conserve sa primauté car elle repose sur des liens de sociabilité plus solides que les autres, ayant pour cadre la famille (rappelons que l’appartenance ethnique est avant tout un fait de filiation). Les liens familiaux – parenté large ou étroite – ont comme force de ne pas relever d’un choix. On ne change pas de famille comme de parti. La famille est en outre une structure au fonctionnement relativement consensuel, dont l’organisation tend à atténuer la conflictualité inhérente aux relations sociales, ce qui la rend plus solide et durable. Bref, tant que la famille, sous des formes variées, reste la cellule de base de l’existence d’un peuple, l’identité ethnique n’est pas irrévocablement menacée, et peut toujours ressurgir.
5/ Enfin, on devine un trait commun aux quatre points évoqués, qui les explique, les résume et leur donne toute leur perspective : l’appartenance ethnique est prégnante, incroyablement résiliente, car elle se situe dans le domaine de l’immanence. Elle ne se définit pas donc ne se contredit pas ; en deçà et au-delà de l’intellectualité, elle ne peut être réfutée sur la base d’arguments rationnels. Les origines des peuples se dérobent à la connaissance scientifique ; il est donc parfaitement vain d’en railler le caractère mythique. Cette absence de définition notionnelle et empirique précise explique la grande plasticité du fait ethnique, qui lui permet de se fondre dans un moule et d’en changer quand celui-ci est brisé : un sentiment ethnique peut se loger dans une idée (nationale, religieuse, politique) jusqu’à paraître dominé par celle-ci, mais presque toujours il lui survivra. La succession des rhétoriques anti-impérialistes des anciennes colonies, tour à tour nationaliste, socialiste ou religieuse, l’illustre de façon implacable.
Par-delà les thématiques a perduré l’expression du particularisme ethnique de groupes qui ne veulent ni ne peuvent être dissous.
*
* *Au final, si nous arrivons à la conclusion que l’appartenance ethnique prime sur les autres, et qu’elle contribue au maintien des solidarités organiques en dépit du processus d’atomisation sociale qui caractérise l’hypermodernité, c’est qu’elle définit un nous cohérent et un eux bien délimité. L’existence d’une frontière entre les deux entités est une nécessité anthropologique absolue ; pour reprendre la métaphore de Régis Debray, cette frontière, qui peut être visible ou invisible, est aux sociétés ce que la peau est au corps : une protection, un filtre et une interface.
L’hypermodernité prétend se passer de cette frontière et de son contenu comme éléments structurant la vie sociale ; un monde d’individus faisant société, harmonieusement, par des choix rationnels libres et consentis en est la finalité. Le spectacle du monde laisse perplexe quant à la réalisation de ce dessein.
Cédric Bellanger (Polémia, 28 février 2016)